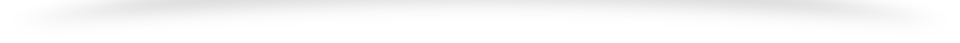Appel à témoignage sur près d’un millier de cas avérés d’enlèvements par l’armée française à Alger en 1957
par Fabrice Riceputi
« J’appris que les morts qui ont été nommés et comptés ne sont pas perdus. »
Alexis Jenni, xxxx
Après soixante et un ans, la France vient enfin de reconnaître officiellement que l’assassinat par l’armée française de Maurice Audin en juin 1957 a été un crime d’État (?). Pour tous ceux qui ont lutté depuis si longtemps pour faire reconnaître cette vérité, c’est une immense victoire – souvent posthume pour certains de ceux qui s’y sont engagés et ont disparu depuis. C’est aussi la seule forme de justice qui peut aujourd’hui être rendue dans cette affaire. Elle n’a que beaucoup trop tardé. Cependant, il convient de rappeler à cette occasion que le meurtre du jeune mathématicien et militant communiste, grossièrement maquillé ensuite en évasion, ne fut nullement une bavure. Maurice Audin fut, parmi des milliers, l’une des rares victimes alors connues par l’opinion française d’un véritable système de terreur militaire sciemment organisé par le gouvernement du « socialiste » Guy Mollet sur la base des dispositions législatives adoptées par les institutions de la République. Si les militaires s’en prirent à lui, c’est qu’Algérien d’origine européenne, membre du Parti communiste algérien (PCA), il s’était rangé aux côtés du FLN, devenant du même coup partie intégrante d’une population colonisée tout entière prise pour cible car collectivement suspecte. Celle-ci fut massivement victime d’arrestations par enlèvements, de détentions clandestines, de torture et, parfois, de mort sous la torture ou par exécution sommaire. Cela est aujourd’hui amplement établi par l’historiographie.
Mais les historiens se heurtent à une difficulté qui facilite l’occultation de l’ampleur véritable de ce crime d’État colonial et de masse : l’impossibilité d’en affiner un bilan humain véritable, faute de sources suffisantes. Celle-ci est inhérente à toute recherche sur les répressions de masse en situation coloniale[1] : le statut politique des victimes au moment des faits les rendait pour ainsi dire invisibles et les a largement condamnées à le rester.
Civils et militaires français impliqués dans la répression savaient que des méthodes interdites et largement réprouvées normalement pouvaient être utilisées librement et en toute impunité à Alger, car elles visaient une population dépourvue de recours judiciaire et politique, sans moyens d’alerter et d’émouvoir une opinion française déjà fort peu disposée à s’inquiéter de son sort : des colonisés « Français musulmans », sous-citoyens racisés tout juste sortis officiellement de l’indigénat et dénués d’existence politique réelle, collectivement suspects par essence de complicité avec une « rébellion » illégitime et meurtrière. Qui s’en souciait vraiment ? Et quelles preuves de leurs supplices subsisteraient pour corroborer leurs éventuels témoignages, à supposer que ces derniers fussent entendus un jour ?
Certes, à la marge, quelques dysfonctionnements dans ce régime d’anonymat et d’irresponsabilité dans la répression[2] se produisirent en 1957, dont l’affaire Audin fut le principal. Les militaires s’en prirent parfois à des personnalités disposant de relais dans l’opinion métropolitaine. Ils ne purent alors éviter entièrement la publicité de leurs crimes. Ainsi, on apprit également le sort tragique d’Ali Boumendjel, avocat connu, torturé et « suicidé » par ses geôliers, et celui de l’auteur de La Question (1958), le militant communiste Henri Alleg, atrocement torturé.
Qui étaient tous les autres et combien furent-ils, ces invisibles dont le sort ne fut jamais une « affaire française[3] » ? L’héroïque Paul Teitgen, secrétaire général à la préfecture, tenta de compter autant que possible « les vivants et les morts[4] » parmi les 24 000 assignations à résidence officielles de « suspects » qu’il obligea que lui demandèrent de signer les militaires à lui faire signer. Mais les « 3 024 disparus » qu’il dénombra ainsi ne sont en réalité qu’un ordre de grandeur plausible, calculé sans réels moyens de parvenir à une vérité qui restait très largement dissimulée par les militaires[5]. En l’absence de sources statistiques fiables, inexistantes par définition puisque l’armée cherchait à dissimuler n’archiva pas ses crimes et que le gouvernement, la justice, la presse regardaient ailleurs, nous ne pourrons donc jamais répondre à ces questions autrement que par des termes généraux et des estimations grossières et incertaines. L’État algérien lui-même en a une connaissance au moins partielle, mais qu’il ne communique pas[6].
À ce titre, la « disparition » de Maurice Audin reste particulièrement emblématique : son meurtre par l’armée ne fait aucun doute, mais quelle justice rendre pour un tel crime sans témoins directs, sans coupables ni mode opératoire identifiés avec certitude et sans cadavre[7] ? L’absence d’archives accessibles faisant preuve de façon certaine a longtemps servi de prétexte pour éviter toute reconnaissance officielle. C’est en somme la seule vraie victoire posthume des « seigneurs de la guerre aux terrifiants caprices », selon les mots de Sartre (Sartre) [ajouter en note la référence à « Une victoire »] et de ceux qui leur donnèrent carte blanche. À l’impunité judiciaire dont ils bénéficièrent[8] s’ajouta automatiquement une sorte d’impunité devant l’histoire : l’occultation de l’identité des victimes et de leur nombre exact permet toujours au doute de faire son œuvre.
C’est dans ce contexte historiographique et mémoriel qu’une archive publique récemment localisée découverte revêt, à notre avis, une certaine importance. Elle fournit un échantillon conséquent important et représentatif de la masse innombrable et anonyme des « humiliés dans l’ombre[9] » durant la Grande Répression d’Alger[ajouter en note ou autrement que c’était l’expression que Gilbert Meynier proposait de substituer à « Bataille d’Alger »], de quoi faire ressurgir leurs histoires humaines particulières. Nous publions en effet ici une liste d’environ de plus de neuf cents [d’un millier d’] Algérois dont nous savons trois choses de manière certaine : ils furent sans conteste arrêtés au cours de l’année 1957 par l’armée française ; leurs proches réclamèrent de connaître leur sort aux autorités de l’Algérie française, le plus souvent – pour 70 % d’entre eux – en vain ; nombre d’entre eux, dans une proportion encore inconnue, furent torturés, et certains ne reparurent plus jamais.
De la majorité, nous ignorons tout, hormis ce que nous en dit cette archive de la préfecture d’Alger. Cette liste est en effet tirée d’un fichier conservé aux Archives nationales de xxx d’Outre-mer (ANOM) depuis la fin de la guerre d’Algérie, dans le fonds les archives d’un service de la préfecture d’Alger, le Service des liaisons nord-africaines (SLNA)[10]. Librement consultable depuis 2017, ce fichier comporte plusieurs centaines de « fiches de renseignement » remplies entre la fin février et la fin août 1957. Au moins 1200 fiches de ce fichier ont disparu, puisque selon les bilans statistiques de septembre 1958 qui ont été conservés, il y aurait eu au total 2049 fiches de ce type à cette date, mais il semble que le service ait continué après. Ces formulaires imprimés sont établis sur un modèle connu, celui de l’avis de « recherche dans l’intérêt des familles » diffusé par l’État pour retrouver une personne dont la disparition est jugée inquiétante. Nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, circonstances précises de la « disparition » d’un Algérien y sont consignés. Ils se terminent le plus souvent par : « Personne à prévenir en cas de découverte. » [Figure1 : une fiche type] Mais, ici, il n’existe aucun doute sur le responsable de la « disparition » qui, bien que tout à fait inquiétante, n’en était pas vraiment une : c’était l’armée française, à laquelle, du reste, ces fiches étaient destinées.
Aux informations provenant de cette source essentielle, nous avons ajouté celles qui viennent d’autres sources, administratives, de presse ou autres. En particulier du « Cahier Vert », publié dans Témoignages et documents en octobre 1959, n°17, dans Les Temps modernes, [n° et date ?], et, en livre, aux éditions La Cité, à Lausanne, « en collaboration avec le Comité Maurice Audin et le Centre d’information pour la défense des libertés et de la paix », avec une postface de Pierre Vidal-Naquet, « Le cahier vert expliqué » (déjà présente dans Témoignages et documents).
En effet, par la voix de son préfet d’Alger, Serge Baret, la République française demandait en xxx mois 1957 aux responsables de sa propre armée de bien vouloir lui indiquer ce qu’étaient devenues des personnes que, devant témoins, sur son ordre et en son nom, elle avait enlevées par milliers, sans aucun justificatif et sans fournir de motif ni d’information sur leur destination, selon un mode opératoire fort éloigné de toute procédure connue d’arrestation et qu’on peut qualifier d’enlèvement. On lira en [Annexe 2 : Néant trouver ni mort ni vivant] l’histoire complète de ce bien curieux service public par temps de terreur coloniale.
On trouvera donc ici, dans l’ordre alphabétique, la liste des quelque xxx noms et prénoms de victimes des « paras », fichées par la préfecture d’Alger ou connues par d’autres sources. Sont également indiquées leurs dates de naissance — quand on les connaît — et dates d’arrestation, des éléments pouvant permettre, nous l’espérons, d’éventuelles identifications et témoignages, puisque, nous le savons, la mémoire de leurs drames, si elle est restée confinée le plus souvent dans la sphère privée, ne s’est pas éteinte.
Sans surprise, beaucoup de ceux dont nous savons déjà ce qui leur est arrivé sont des Algériens d’origine européenne, le plus souvent membres du Parti communiste algérien[11]. Parmi ces derniers, tous ont été détenus au secret et souvent torturés, deux [ ???] ont « disparu ». Les personnes identifiées font l’objet de notices individuelles [Annexe 3]. Mais, dans 99 % des cas, les membres de notre échantillon sont des « Français musulmans » – on compte seulement onze femmes, dont une seule « Européenne » –, des « inconnus » personnes dont l’arrestation n’a laissé, sauf exceptions, d’autre trace dans les archives françaises que cet avis de recherche. 64 % ont été appréhendés chez eux entre 22 heures et 6 heures du matin, 22 % sur leur lieu de travail et 14 % sur la voie publique lors de rafles et de contrôles inopinés. Leur moyenne d’âge était d’une trentaine d’années. Beaucoup étaient déjà mariés et pères de famille et exerçaient très majoritairement des métiers peu rémunérateurs tels qu’ouvrier, docker, petit marchand de souk, garçon de café ou manœuvre. Mais 6 % avaient entre quatorze et dix-huit ans, quelques-uns plus de soixante. Le croisement de cette liste avec d’autres documents montre notamment pour quelques dizaines d’entre eux qu’ils étaient toujours recherchés par leurs familles en août 1959, soit jusqu’à deux ans et demi après leur enlèvement.
Puisse cette publication contribuer à leur rendre leurs histoires longtemps occultées.
[Mode d’emploi]
[1] Qu’il s’agisse par exemple de la répression de mai-juin 1945 dans le Nord-Constantinois ou du massacre des manifestants algériens à Paris le 17 octobre 1961, mais aussi de la répression à Madagascar en 1947 ou au Cameroun de 1955 au début des années 1970.
[2] Le haut fonctionnaire Paul Teitgen qui en fut le civil le mieux informé dénonça en ces termes un « système » de terreur instauré à Alger dans sa lettre de démission à Robert Lacoste, le comparant à celui des nazis.
[3] Malika R
[4] PVN
[5] Branche, histoire apaisée ; Riceputi, XXe siècle
[6] Martyrs
[7] Voir Annexe « Ni morts ni vivants »
[8] Sur la « drôle de justice » durant la guerre d’Algérie, voir ST
[9] PT
[10] Cote SLNA
[11] Sur les communistes algériens, voir Pierre-Jean Le F-L, thèse + site internet. Nous le remercions pour son précieux concours dans l’identification de ces personnes.